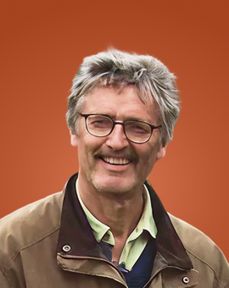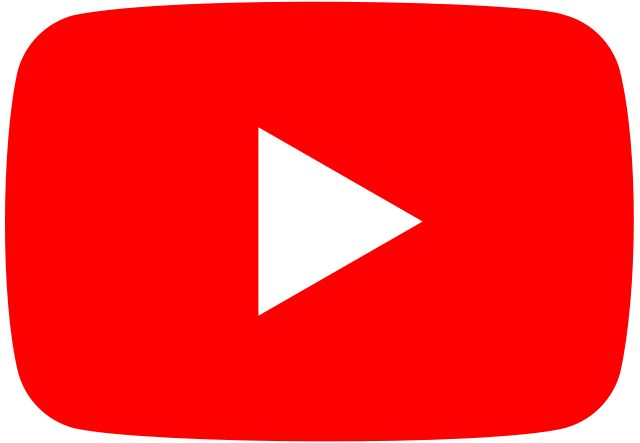Le jardin monastique, miroir de l'ordre divin
Les jardins monastiques médiévaux sont, en plus de leur dimension pratique, le support d’une vision symbolique et spirituelle du monde et de la nature.
Les premiers jardins monastiques sont irlandais, et s’inspirent des topiarii romains (les topiaires) – qui présentent des arbres et des arbustes taillés dans un but décoratif. Ils se diffusent en Europe, notamment en Suisse, en même temps que la règle irlandaise. Le plan des jardins de l’abbaye de Saint-Gall, en Suisse alémanique justement, est un parfait exemple de la manière monastique du début du Moyen Âge. Au centre des allées en croix qui divisent les quatre quartiers du cloître se trouve un arbuste aux feuilles rouges. Un premier symbole : c’est pour cette couleur qu’il a été choisi, car elle évoque le sang du Christ et sa Passion (tous les événements qui ont accompagné sa mort).
Plantes médicinales et vertus morales
Les jardins en eux-mêmes sont divisés en trois parties distinctes : l’hortus, le pomarius et l’herbularius. Le premier, l’hortus, est introduit par une plaque gravée à cette phrase : « Ici mûrissent les légumes qui se développent magnifiquement ». Il s’agit du jardin potager, destiné à nourrir les moines et à faire commerce. Le pomarius est un verger-cimetière : entre les tombes sont plantées treize essences d’arbres fruitiers – desquelles le pommier, symbole du péché originel, est quasiment absent. Enfin, l’herbularius, à proximité immédiate de l’infirmerie, est le jardin des simples (simplicis medicinae ou simplicis herbae, les plantes médicinales). Les moines ont une connaissance empirique des effets des plantes médicinales, et il n’est pas rare que le moine herboriste joue aussi le rôle d’apothicaire ou de médecin au sein de l’abbaye. La pharmacopée médiévale se divise en six catégories : les plantes vulnéraires (censées guérir les plaies), les plantes de maux de ventre, les plantes de purges, les plantes antivenimeuses, les plantes des femmes (censées apporter la beauté et guérir les afflictions féminines) et les plantes contre les fièvres. À l’époque, on associe bien souvent les vertus supposées des plantes à leur apparence. Par exemple, les taches blanches présentes sur les feuilles de la pulmonaire évoquent la forme des alvéoles des poumons ; on lui prête alors la capacité de traiter les maux respiratoires, et on la nomme en conséquence. Ceci est une parfaite illustration de la conception médiévale du monde : les choses en elles-mêmes ne sont pas importantes, la réalité spirituelle à laquelle elles renvoient prime.
À lire aussi : L'utopie et le jardin anglais

Martin Schongauer, Vierge à l'Enfant dans un jardin de roses, 1472 | Wikimedia Commons
La nature comme expression divine
En cela, le jardin monastique médiéval diffère profondément de notre vision contemporaine de la nature. Au Moyen Âge, on imagine le monde terrestre comme un reflet imparfait du monde divin. La nature est envisagée sous un angle spirituel plutôt que concret, et l’on perçoit les choses comme des signes de l’ordre cosmique — que l’on cherche aussi à reproduire dans les constructions et les agencements végétaux. Le monastère, par sa position isolée et sa dimension calme et solitaire, renvoie à l’image d’un Paradis terrestre. En faisant pousser dans leurs jardins des plantes associées à des valeurs positives, les moines cultivent symboliquement les vertus. Le lys par exemple est un signe de pureté ; l’iris, dont la forme rappelle un sceptre, est considéré comme un manifeste de la royauté divine ; le fraisier, caché au milieu d’autres herbes, symbolise l’humilité ; les roses blanches représentent l’Immaculée Conception de Marie, tandis que les rouges renvoient aux martyrs et à la Passion du Christ. Le jardin, dans cette conception médiévale, est à la fois un lieu réel et allégorique, où le divin s’exprime en permanence. Progressivement, cette vision évolue : on voit toujours un contenu symbolique et la main de Dieu, mais on s’intéresse aussi à l’esthétique et à la dimension sensible de la nature. À partir du XIVe siècle, elle est mise en avant en tant que telle.
Dans cette lignée, un nouveau thème iconographique et poétique se développe, et devient récurrent dans l’art religieux européen : Marie représentée dans un hortus conclusus – un « jardin enclos ». Cet espace ceint de murs, comme protégé du monde extérieur, et planté des essences symboliquement associées à la Vierge, fait une référence directe au jardin d’Éden, et renforce encore l'imaginaire d'une nature étroitement liée à la divinité.
Aujourd'hui, la redécouverte et la mise en avant de ces espaces — qu'ils soient des jardins monastiques conservés ou reconstitués à l'identique — démontrent une fascination pour l'auto-suffisance et les espaces raisonnés, à l'heure d'une crise écologique. Si la conception spirituelle du jardin médiéval n'est plus d'actualité, on peut toujours le reconnaître comme un modèle d'équilibre et d'harmonie.
Anna F.
Nos voyages Art des jardins vous entraînent au cœur des plus beaux sentiers du monde.

autres articles
découvrez nos catalogues
Voyages susceptibles de vous plaire