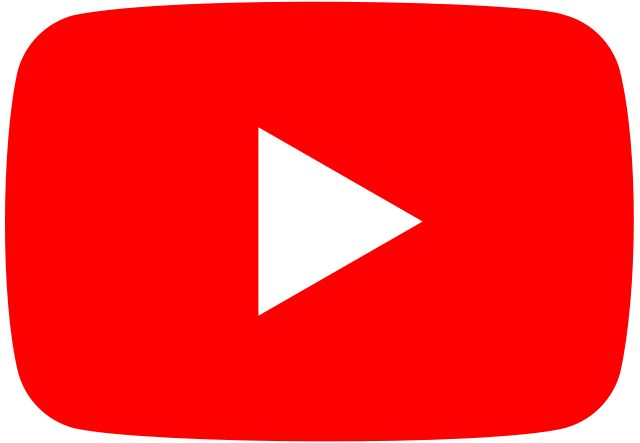Uruk, la « première ville du monde » : les débuts de l'urbanisme
Haut lieu de la Mésopotamie entre 4000 et 2000 avant J.-C., Uruk est considérée par de nombreux experts comme la plus ancienne ville du monde, et un des premiers exemples d’urbanisme réfléchi.
Monte déambuler sur le rempart d’Uruk, scrute les fondations, contemple le briquetage : tout cela n’est-il pas brique cuite ? Et les Sept Sages, en personne, n’en ont-ils pas jeté les bases ? Trois cents hectares de ville, autant de jardins, autant de terre vierge – c’est l’apanage du temple d’Ishtar. Avec ces mille hectares, tu couvres du regard l’entier domaine d’Uruk
L’Épopée de Gilgameš. Le grand homme qui ne voulait pas mourir, traduit de l’akkadien et présenté par Jean Bottéro, Gallimard, 1992
C’est ainsi qu’est décrite la cité mésopotamienne dans L’Épopée de Gilgamesh, récit épique sur le roi semi-légendaire éponyme, considéré comme l’une des œuvres littéraires les plus anciennes de l’humanité, puisque la première version connue du texte remonte au XVIIIe siècle avant J.-C. La ville d’Uruk, située au sud de l’actuel Irak, a été un des centres névralgiques de la Mésopotamie pendant plus de deux millénaires.
Du village à la ville
Uruk est surnommée « la première ville du monde ». L’assertion fait débat chez les archéologues, mais il est certain qu’il s’agit d’une des plus anciennes agglomérations à atteindre le stade de « ville » plutôt que de « village » au IVe millénaire avant J.-C. Uruk couvre d’abord 70 hectares, jusqu’à s’étendre sur environ 250 hectares vers 3000 avant J.-C. On estime que durant cette période, la ville compte environ 40 000 habitants – contre des populations oscillant entre 4000 et 20 000 habitants au maximum pour les autres centres urbains, comme Ur et Eridu en Mésopotamie, Nekhen et Memphis en Égypte, ou Liangzhu en Chine. Outre sa superficie et son influence, Uruk se distingue aussi par la monumentalité de ses édifices.

Site archéologique de Warka, ancienne Uruk, Irak | SAC Andy Holmes (RAF)/MOD, OGL v1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92957174
Une architecture monumentale : démonstration de pouvoir
Les palais mésopotamiens, que l’on appelle les « grandes maisons », sont composés d'un ensemble de bâtiments, sur le modèle des habitations ordinaires, mais sont bien plus imposants. S’y retrouvent à la fois la fonction domestique (lieu de vie du roi et de sa famille) ; administrative (siège du pouvoir, des décisions, et lieu de conservation des archives) ; religieuse (un espace dédié aux dieux) ; et publique (puisque les habitants sont admis dans plusieurs parties de la grande maison). Seuls les temples le disputent aux palais en termes de taille. Sur la colline sacrée de Kullaba se dresse celui d’Anu, dieu du ciel, surnommé « le temple blanc » en raison de son enduit de plâtre clair. Érigé sur une haute terrasse de brique crue, considérée comme l’une des premières formes de ziggurat, il domine la cité et sert à la fois de lieu de culte et de symbole du pouvoir divin. Au sud, le quartier d’Eanna, dédié à la déesse Inanna (associée à la fertilité et à la guerre), rassemble plusieurs temples et cours monumentales, construits et reconstruits au fil des siècles. Ce vaste complexe, riche en dépôts votifs et en tablettes gravées, illustre l’importance capitale de la religion dans la vie des Mésopotamiens et des habitants d’Uruk. Cette omniprésence se traduit non seulement dans les édifices religieux, mais aussi dans l’intégralité du plan de la cité.
À lire aussi : De l'archéologie au tourisme, la redécouverte des sites grâce aux fouilles
La cité comme création divine
Car dans la civilisation mésopotamienne, le plan et l’architecture d’une ville répondent à une vision cosmologique : construire un espace urbain, c’est imiter l’action créatrice des dieux. À Uruk, cette idée se matérialise dans les deux grands ensembles religieux : le temple d’Anu, dressé sur une terrasse haute, joue le rôle d’axis mundi (« axe cosmique »), reliant symboliquement le ciel, la terre et le monde souterrain, dans un alignement soigneusement orienté selon les points cardinaux. Le sanctuaire d’Inanna associe architecture monumentale et décor symbolique ; les façades à niches et contreforts, les briques décorées et les inscriptions royales relient directement l’édifice à la déesse tutélaire de la ville et au souverain bâtisseur. Les voies processionnelles qui relient ces ensembles guident les déplacements lors des rituels et inscrivent la ville dans un ordre sacré. Chaque espace participe ainsi à une mise en scène où la ville devient la réplique terrestre du cosmos, garantissant la protection des dieux et la légitimité du pouvoir royal.

Arches en briques sur le site de Warka, ancienne Uruk, Irak | Dave Primov via Getty Images
Les débuts de l’urbanisme, une ville réfléchie
Empreint à la fois de symbolisme et de praticité, l’organisation de la cité ne doit donc rien au hasard. Le site d’Uruk présente des quartiers différenciés – zones résidentielles, artisanales, religieuses - des rues au tracé bien défini et un système complexe de canalisation. Ces caractéristiques laissent penser que le plan de la ville a été réfléchi et planifié, avec la volonté d’organiser les espaces en conciliant les besoins des habitants avec les contraintes sociales, religieuses et économiques. Cet aménagement conscient fait d’Uruk un des premiers exemples d’urbanisme de l’histoire.
Anna F.
Découvrez les voyages culturels au Moyen-Orient d'Intermèdes, avec un guide-conférencier.

autres articles
découvrez nos catalogues
Voyages susceptibles de vous plaire

















%20-%20Vienne%20@GettyImages%20-%20Vitold%20Drutel.jpg?ratio=80)