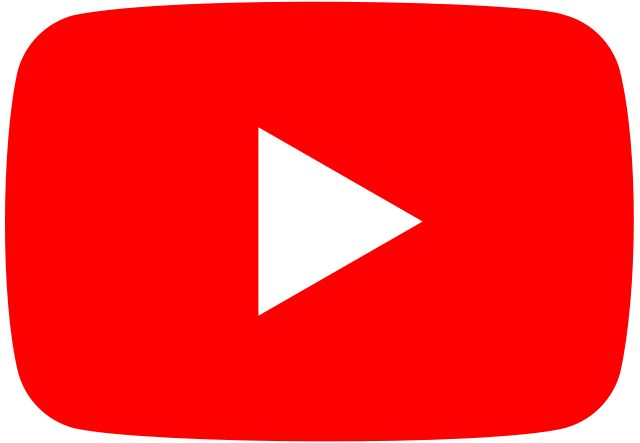Les « arbres de la liberté » : mémoire dans l’espace public
À partir de 1790, après la Révolution française, près de 60 000 « arbres de la liberté » sont plantés à travers le territoire, matérialisant dans l’espace public l’adhésion aux idéaux révolutionnaires. Chênes, ormes, tilleuls ou peupliers, certains sont encore debout, d’autres ont été plantés au fil des années.
Les arbres de la liberté soumis aux fluctuations politiques
La plantation d’un arbre de la liberté obéit à un protocole : discours civiques, rassemblement municipal, parfois célébration religieuse (notamment dans les premières années, avant la radicalisation anticléricale). Le décret du 3 pluviôse an II (22 janvier 1794) rend ces plantations obligatoires dans les communes.
Le sort des arbres de la liberté suit de très près les fluctuations politiques du pays. Sous la Restauration, plusieurs d’entre eux sont arrachés par les autorités. D’autres sont replantés en 1830, 1848 ou encore après la chute de Napoléon III. Ils apparaissent et disparaissent au gré des changements de régime.

Henri Valentin, Destruction des arbres de la liberté, 1850 | Wikimedia Commons
Les arbres de la liberté pour commémorer
La fin des années 1980, marquée par les célébrations du bicentenaire de la Révolution française, a donné lieu à plusieurs réactivations de la pratique. Le 21 mars 1989, le président François Mitterrand participe à une cérémonie officielle à Saint-Gaudent, en Nouvelle-Aquitaine. Cette ville est identifiée comme le tout premier lieu de plantation d’un arbre de la liberté pendant la Révolution, en janvier 1790. Pour commémorer cet événement, un chêne est planté, devant les autorités locales et les habitants.
Le 25 novembre 1989, à Millau (dans l’Aveyron), 1 789 élèves des écoles de la ville sont invités à planter chacun un pin noir d’Autriche, variété choisie pour sa résistance au climat local, dans une vaste plaine aménagée à cet effet. Le nombre d’élèves fait évidemment écho à l’année de la Révolution.
Les arbres de la liberté aujourd’hui
Certains arbres plantés à la fin du XVIIIe siècle ont survécu, notamment dans l’ouest et le sud-ouest de la France. À Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire), le tilleul planté en 1794 a été classé arbre remarquable ; le platane de Bayeux a aussi traversé les siècles, comme les arbres de Caunes-Minervois, Flixecourt, Ronquerolles ou Franconville. Le chêne d’Oradour-sur-Glane, toujours debout, a été planté en 1848 avec l’avènement de la Seconde République.
D’autres arbres – naturels ou artificiels – ont été érigés depuis pour diverses occasions. On peut les voir un peu partout en France : à Paris, à Soissons ou à Eycheil.
Anna F.
Découvrez nos voyages culturels en France et nos journées culturelles.

autres articles
découvrez nos catalogues
Voyages susceptibles de vous plaire

















%20-%20Vienne%20@GettyImages%20-%20Vitold%20Drutel.jpg?ratio=80)